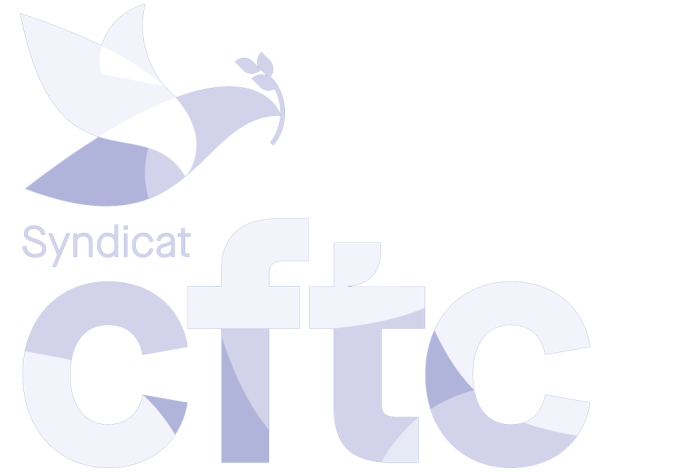Une version unique du vivre ensemble
Frédéric Turlan est directeur d’IR Share, correspondant national pour la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound). Avec lui, nous avons voulu cerner le sens d’une Europe des travailleurs.
Qu’est-ce qui lie les travailleurs européens ?
Dans l’Union européenne, les travailleurs ont accès à une forme de démocratie au travail : toutes les entreprises de plus de 50 salariés sont censées avoir une représentation du personnel. Tous les travailleurs européens sont couverts par un système de sécurité sociale (certes très variable). Et tous bénéficient d’un droit du travail européen relativement protecteur, même s’ils ne le voient pas forcément puisqu’il est transposé dans leur droit national. Ainsi, l’UE est la seule zone géographique mondiale où l’on parvient à allier législation sociale, protection sociale et démocratie au travail dans le même espace.
Le Smic européen pourrait-il être un autre point commun ?
Le Smic européen unique ne verra pas le jour. Ce n’est pas réalisable compte tenu des différences de niveaux économiques entre les pays et cela heurterait plusieurs États membres. En revanche, la directive du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’UE est transposée depuis mi-novembre dernier dans les droits nationaux. Elle vise à ce que le plus de travailleurs possible soient couverts par une convention collective prévoyant notamment un salaire minimum. On demande aux États membres d’atteindre un taux de 80 % de couverture conventionnelle.
D’où partons-nous ?
L’objectif est ambitieux car seulement sept d’entre eux ont un taux supérieur (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie et Suède), tandis que près d’une dizaine sont entre 6 % et 30 %. L’objectif est d’éviter le phénomène des travailleurs pauvres. Et ça commence à marcher : les salaires minimaux ont été relevés dans certains pays grâce à la directive. Il n’y a donc pas de salaire minimum uniforme en Europe, mais l’UE veut parvenir à une définition similaire du salaire minimum — au moins 60 % du salaire mensuel net médian ou 50 % du salaire mensuel net moyen — portant le revenu minimum du travailleur au-delà du seuil de pauvreté. En espérant que la dynamique enclenchée par la négociation collective ait aussi un impact sur les autres niveaux de salaire. Mais le Danemark a attaqué la directive sur le salaire minimum, avec le soutien de la Suède. Cet été, ce différend pourrait ainsi être tranché par une décision de la Cour de Justice attendue cette année.
C’est-à-dire ?
L’UE a compétence dans un certain nombre de domaines : santé et sécurité, temps de travail… À l’inverse, il y a des domaines pour lesquels aucune compétence ne lui est dévolue : harmoniser le droit de grève, légiférer sur la façon dont on négocie les salaires… Et c’est là que le bât blesse. Le Danemark et la Suède estiment que la directive interfère dans la façon dont on fixe les salaires et qu’elle empiète sur l’autonomie des partenaires sociaux. Si la Cour de justice estime que la directive a violé le traité, celle-ci tombe.
Quelles autres tendances sont à l’œuvre ?
Sur la législation sociale, jusqu’à maintenant, il n’y a jamais eu de recul. Notamment parce que les directives européennes fixent des standards minimaux et prévoient à chaque fois une clause de non-régression (les États ne peuvent pas réduire la protection accordée par leur législation si elle est plus favorable que le standard européen). Mais le risque de régression n’est pas à exclure ! La Commission a déjà taillé en pièces deux directives qui viennent d’être adoptées sur les rapports de durabilité et le devoir de vigilance. D’autres déréglementations sont en préparation via des directives omnibus.
Qu’est-ce qu’une directive omnibus ?
Une directive omnibus révise une série de textes européens dans un champ déterminé. Elle est aujourd’hui utilisée comme moyen de détricoter un certain nombre de directives qui entraveraient, selon certains, la liberté économique des entreprises. Cela commence à bas bruit. Premier exemple : pour renforcer l’industrie de la défense, la Commission a envisagé de revoir certains aspects de la directive sur le temps de travail. Une tentative dénoncée par la fédération syndicale IndustriALL Europe². Deuxième brèche : la Commission essaie de faire passer l’idée d’un allègement du droit du travail (ainsi que du droit fiscal et du commerce) pour les start-up, sous prétexte qu’elles auraient trop de contraintes lorsqu’elles sont en phase de lancement.
Et troisième signe inquiétant : BusinessEurope, le patronat européen, s’oppose à toute réglementation de l'IA sur le lieu de travail et demande que l'on revienne sur les garanties apportées en la matière par la directive "travailleurs des plateformes".
Jusqu’à présent, le patronat ne touchait pas à ce qui était acquis et demandait au pire, le gel de la législation sociale au motif de l'intégration de nouveaux Etats membres ou d'une crise. Aujourd'hui, on entend que déconstruire le droit du travail pourrait être une bonne idée pour relancer l’économie européenne.
« Le modèle démocratique européen est en train de faiblir »
De quels moyens d’action les syndicats disposent-ils ?
À l’échelle européenne, les fédérations professionnelles (IndustriAll Europe, par exemple) ou la Confédération européenne des syndicats (CES) alertent sur ces éléments inquiétants mais peinent à se faire entendre pur protéger les intérêts des travailleurs... Surtout face à des milliers de lobbyistes. Elle ne peut que s'appuyer sur les confédérations nationales afin qu'elles agissent auprès de leurs Députés européens, de leurs gouvernements, pour pointer du doigt les risques.
Ce détricotage ne concerne-t-il pas aussi le Green Deal ou “Pacte vert pour l’Europe” ?
L’objectif du Pacte vert est de rendre l'économie européenne plus durable. Il s'agit de rassurer les financiers pour que leurs placements et investissements ne soient pas trop risqués par rapport à l'impréparation des entreprises face au changement climatique. Cela avait un côté vertueux d'avoir des objectifs de protection de l'environnement qui visaient à rendre l'économie plus sûre. C'était une bonne nouvelle aussi pour le monde salarial, car, comme le dit justement la CES : "Il n'y a pas d'emploi sur une planète morte". Les parties souvent en conflit que sont les investisseurs et les travailleurs se trouvaient reconciliées sur ce point. Mais depuis 2 ans, on part en sens inverse : On observe une tendance à sacrifier les objectifs que l'on s'était fixés. Les rapports de durabilité sont de plus en plus allégés, au détriment d'une bonne partie des entreprises qui y voyaient des avantages. Je peux citer EDF, qui a besoin d'investissements conséquents et qui, pour emprunter de l'argent à des taux intéressants, doit montrer qu'ils sont durables et sécurisés.
Qu’en est-il du dumping social au sein de l’UE ?
L’importation des produits fabriqués dans des pays qui pratiquent le dumping social ou pire l'esclavage moderne - sans compter les atteintes environnementales - a des impacts défavorables pour les travailleurs européens. Si on importe de l'acier chinois beaucoup moins cher que l'acier européen, par exemple, cela met en péril l'industrie sidérurgique européenne et donc l'emploi des travailleurs de ce secteur. Mais d'autres phénomènes sapent également l'europe sociale. De plus en plus de travailleurs sortent de la protection du droit du travail. On pense évidemment aux travailleurs indépendants de l'économie des plateformes : les coursiers Deliveroo, les chauffeurs Uber, ... Ils sont en dehors du champ du salariat, bénéficient d'une protection moindre et les "employeurs" ne paient pas de cotisations sociales. Et il y a plus inquiétant : Le recours à l'esclavage moderne en Europe avec l'appel à des ressortissants d'Etats tiers, surtout dans l'agriculture ou dans le transport routier des marchandises. C'est massif et ces gens peuvent être extrêmement maltraités, alors que les règles européennes sont protectrices !
Sur ce point, quels remèdes sont possibles ?
Des propos politiques désignent parfois le détachement des travailleurs(4) comme l'alpha et l'oméga de l'horreur sociale. Or ce dispositif est parfaitement sécurisé par des directives européennes.
Par exemple, la législation sociale des chauffeurs routiers est claire : Ils devraient être payés au moins au salaire minimum des pays traversés ; sont sensés se reposer chez eux tous les 15 jours, ... Sauf que cela n'est pas appliqué . Même chose sur les chantiers ! Le problème, ce ne sont pas les règles européennes, mais leur non-application, ainsi que l'insuffisance des contrôles. On peut parler de volonté des états membres de ne pas contrôler.
Quels défis l’UE va-t-elle devoir relever ?
On accepte que des pays européens soient de moins en moins démocratiques et ce n'est pas bon signe. Le modèle démocratique européen est en train de faiblir. Il me semble important de réfléchir à comment protèger et renforcer ce socle de l'UE, par rapport à tous ceux qui proposent de "courir" derrière les Etats Unis ou la Chine. Pour ce faire : Peut-être envisager l'IA et les nouvelles technologies comme des outils au service de la cohésion sociale et de la démocratie plutôt que de démanteler nos règles pour faire le Facebook français ou le Google allemand. De mon point de vue, l'enjeu sera de préserver le vivre ensemble. Il nous faut réfléchir sur la société dans laquelle nous avons envie de vivre.
-
Eurofound est une agence de l'UE dont la mission d'expertise doit servir à l'élaboration de meilleures politiques dans le domaine sociale, de l'emploi et du travail.
-
Organisation de syndicats représentant les travailleurs des industries du métal, de la chimie, de l'énergie, des mines, des textiles, de l'habillement et de la chaussure eet autres industries et activités associés.
-
Publication de données environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprises.
-
La CFTC a toujours été très vigilante au sujet de l'encadrement des règles de détachement.
Conditions de travail
Tous les quatre ans, depuis 1991, Eurofound pilote une étude sur les conditions de travail. Dernière édition : 2024.
Exactement 36 386 travailleurs ont été interviewés en face-à-face, dans 35 pays européens (dépassant les frontières de l’UE). Les résultats finaux seront prêts en 2026, mais des premiers éléments viennent d’être publiés¹. Frédéric Turlan (cf. article ci-dessus) relève ainsi « l’exposition épisodique aux fortes chaleurs, qui a augmenté. En 2024, 21 % des travailleurs ont déclaré avoir été exposés à des températures élevées au moins un quart du temps, contre 13 % en 1995. » Il souligne aussi deux sujets émergents :
-
Le niveau d’utilisation de l’IA générative, qui concernait 12 % des travailleurs en 2024, avec de fortes disparités entre les pays (9 % en France, 25 % au Luxembourg).
-
La prise en compte des règles douloureuses, de l’endométriose et de la ménopause sur le lieu de travail.
Enfin, Frédéric Turlan précise qu’« une problématique partagée par l’ensemble des États membres : les salariés payés au salaire minimum consacrent jusqu’à 35 % de leur budget au logement, contre 26 % en moyenne. »
¹ eurofound.europa.eu
"L'EUROPE SOCIALE EXISTE !"
Comment la CFTC s’investit-elle dans le dialogue social européen ?
Quels combats y mène-t-elle ? Qu’apporte l’UE à nos travailleurs ?
Entretien avec Anne Chatain, secrétaire générale adjointe en charge de l’Europe à la CFTC.
Où se joue le dialogue social européen ?
D’abord dans les groupes qui se sont dotés d’un comité d’entreprise européen. Il doit être informé et consulté sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise ou du groupe. Une réunion extraordinaire est obligatoire en cas de délocalisation, fermeture d’établissement, licenciements collectifs, etc.
Le dialogue social s’organise aussi par secteur d’activité. Les salariés sont représentés par les différentes fédérations syndicales européennes, comme l’Effat (alimentation, agriculture, tourisme), Uni Europa (services) ou IndustriAll (industries manufacturières, mines, énergie). Les fédérations syndicales nationales y adhèrent si elles le souhaitent.
Et au-delà des entreprises et des secteurs d’activité ?
La Confédération européenne des syndicats (CES) regroupe, elle, les confédérations adhérentes de chaque pays et discute régulièrement avec son homologue patronal, Business Europe. Elle a plusieurs fonctions : représentation, négociation et lobbying. Il faut savoir que les lobbyistes européens sont identifiés et opèrent ouvertement. Un accord sur le dialogue social européen prévoit que la CES est consultée avant l’adoption des directives. Elle rend donc des avis sur des textes, rédigés ou en projet, et en propose également. Mais concrètement, elle fait du lobbying dès qu’une directive est en préparation, jusqu’à son adoption.
La CFTC est représentée à la CES par Cyril Chabanier et son suppléant Jean-Philippe Charpentier (cf. son interview p. 28-29).
Enfin, il y a le Comité économique et social européen, qui représente la société civile, les associations, les organisations syndicales et patronales.
La CES a-t-elle un cheval de bataille ?
La CES, dont la CFTC est partie prenante, se bat avant tout pour « des emplois de qualité », c’est-à-dire pour de meilleurs salaires et conditions de travail. En 2022, nous avons ainsi obtenu l’adoption d’une directive salaires, qui favorise la convergence à la hausse des salaires minimums en Europe, afin de garantir un niveau de vie décent des travailleurs. Cependant, le Danemark a déposé un recours en annulation devant la Cour de Justice européenne et nous sommes donc en alerte sur ce sujet. Vis-à-vis de Business Europe et de son fort pouvoir de lobbying, nous devons d’afficher une unité même si des divergences internes sont inévitables.
La CES a aussi contribué à l’adoption de la directive Plateformes d’octobre 2024. Depuis, les plateformes ne peuvent pas licencier sur la base d’une décision algorithmique ou automatisée. Au contraire, les décisions importantes qui ont un effet direct sur les travailleurs de plateforme doivent faire l’objet d’une surveillance humaine. En outre, une présomption de relation de subordination est instituée : en cas de litige, c’est à l’entreprise de prouver que cette relation n’existe pas.
Vous dirigez le groupe Europe de la Confédération CFTC. De quoi s’agit-il ?
Après le Congrès de Rennes, en 2023, je me suis vu attribuer le dossier de l’Europe, dont s’occupait jusque-là Vladimir Djordjevic. Huit militants talentueux et investis m’ont rejoint pour former ce que nous appelons le « groupe Europe », mais nous sommes prêts à intégrer d’autres personnes. Et nous nous réunissons tous les deux mois pour coordonner nos actions, partager les informations, mener des réflexions, notamment sur les positions de la CFTC à relayer à la CES…
Quelles positions la CFTC défend-elle au niveau européen ?
Premièrement, nous pensons que la directive de 2009 sur les CEE est trop peu contraignante pour les employeurs, concernant l’obligation de consultation des CEE et les recours possibles devant les tribunaux. De plus, sa transposition est très inégale d’un pays à l’autre. De ce fait, beaucoup de grosses entreprises vont installer leurs sièges sociaux dans certains pays pour licencier plus facilement. Cela permet de faire du dumping social et fiscal, donc les emplois en France sont aussi en jeu. Alors, quand j’entends que l’Irlande, par exemple, a un fort taux de croissance, c’est aussi parce qu’elle a ainsi pu attirer les entreprises de haute technologie ! Cependant, la CFTC a obtenu une révision de la directive. Certaines parties du nouveau texte sont directement issues de nos demandes, et nous sommes optimistes quant à un aboutissement à l’automne.
Deuxièmement, nous nous inquiétons de la relation algorithmique au travail. Près de 43 millions de personnes travailleraient pour une plateforme numérique dans l’UE. Et ce chiffre augmente de façon exponentielle. On pense aux livreurs et aux chauffeurs de VTC, mais les plus grosses plateformes sont inconnues du grand public. Elles proposent des services juridiques ou comptables, notamment. Certains groupes voudraient étendre ce système, par exemple en faisant travailler des caissières autoentrepreneuses par l'intermédiaire de plateformes. Notre système de protection sociale, qui repose sur les cotisations liées au travail salarié, est donc menacé dans son ensemble. Lors d'un forum sur les plateformes en septembre 2024, à Paris, la CFTC a alerté la population et les pouvoirs publics sur les dangers de la plateformisation du travail. Nous avons obtenu gain de cause avec la directive « Plateformes ». La CFTC aimerait maintenant que les partenaires sociaux soient consultés sur sa transposition dans le droit français.
Et troisièmement, nous voulons avancer sur la conditionnalité des aides d’État versées aux entreprises. Les contreparties exigées sont largement insuffisantes.
L'Europe se trouve à un moment charnière
Comment intervenez-vous au niveau européen ?
Nous intervenons à trois niveaux. D’abord, nous sommes en lien avec les autres syndicaux européens. Nous les alertons sur les sujets qui nous préoccupent. Au sein des fédérations européennes et de la CES, nous formons des alliances avec des syndicats qui ont une sensibilité et des idées proches des nôtres. A la CES, nous nous sommes rapprochés de la confédération allemande Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) et des Irlandais de l’Irish Congress of Trade Unions (ICTU).
Ensuite, nous sommes en relation avec les institutions européennes, qui nous consultent régulièrement, particulièrement à travers les fédérations, parfois en intersyndicale. Parallèlement, nous menons, au nom de la CES ou de la CFTC, un travail de sensibilisation auprès des Ministres et des parlementaires européens. Notre petite taille n'est pas un handicap. En effet, vu la multiplicité des acteurs au sein de l'UE, c'est la relation entre deux personnes qui va être fructueuse.
Enfin, la CES nous lance des "call to action" : Les organisations syndicales françaises sont régulièrement invitées à se coordonner pour relayer les messages de la CES auprès de nos parlementaires, des eurodéputés français et de notre gouvernement.
Quels sont les limites et les atouts de l’Europe ?
On peut reprocher à l’UE la lenteur de son fonctionnement. Mais les 27 pays actuels ont la volonté d’avancer ensemble. Autant d'acteurs aux sensibilités différentes, aux intérêts divergents, qui arrivent à se mettre d'accord, c'est le miracle européen ! Ca fonctionne parce que l'UE, par nature, oblige à composer avec ses partenaires., ce qui exige une construction très argumentée et très concertée des textes de loi. La logique européenne, c'est le donnant-donnant : On lâche quelque chose, et on obtient autre chose en contrpartie. C'est particulièrement vrai dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), dont les discussions pour 2027 commencent dès maintenant. La CFTC s'adapte assez facilement à cette logique parce qu'elle a la culture du compromis. Il y a succès : Encore récemment, la CES a contribué à la directive Stagiaires, en voie d'aboutissement. Les stages seront reconnus comme du travail réel, indemnisé en conséquence. Le revers de la médaille, c'est qu'on a parfois le sentiment de ne pas aller assez loin, comme pour les travailleursau contact des produits chimiques.
Qu’est-ce que les travailleurs français doivent à l’Europe ?
Beaucoup de Français pensent que l’Europe ne sert à rien. Pourtant, elle produit du droit et les salariés français en bénéficient. L’Europe sociale existe !
Un exemple très probant : la directive sur la transparence des rémunérations va obliger la France à aller plus loin que l’index de l’égalité femmes-hommes, au plus tard en juin 2026.
Autre exemple : pour se mettre en conformité avec le droit européen, la France a permis aux salariés d’acquérir des jours de congés payés pendant un arrêt maladie. Et notre pays est encore rappelé à l’ordre concernant la perte de congés payés quand un arrêt de maladie débute pendant les vacances ! Au passage, on se rend compte que l’Union européenne joue un rôle de gendarme supranational, pour obliger les États à appliquer le droit. Par ailleurs, les travailleurs peuvent saisir la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).
Où en est l’Europe sociale aujourd’hui ?
Jusqu’aux dernières élections européennes, en juin 2024, le pilier social de l’UE se renforçait. Mais depuis, on assiste à une libéralisation de l’économie, avec des politiques d’austérité budgétaire, de déréglementation et de simplification des normes. En témoignent le paquet de loi dit "Omnibus" en cours de discussion, qui simplifierait le devoir de vigilance des entreprises. Aujourd'hui, celle-ci doivent être transparentes sur les risques sociauxn environnementaux et de gouvernance, chez elles, mais aussi chez leurs sous-traitants, filiales, fournisseurs, etc... Un abaissement de la réglementation serait un recul énorme.
La CES s’efforce d’infléchir cette politique, et la CFTC s’est très investie sur ce sujet. Certes, l’Europe doit rester compétitive dans un contexte d’équilibre mondial précaire, et les normes sont complexes pour certaines entreprises. Mais cela ne doit pas passer par un détricotage des droits des travailleurs.
Plus généralement, l’Europe se trouve à un moment charnière de son histoire. La guerre est à nos portes, les Américains se désengagent et nous déstabilisent, et nous avançons en ordre dispersé. C’est le moment ou jamais de mieux nous coordonner. L’Europe doit se réinventer !
1. Ces aides atteignent en France 211 milliards d’euros en 2023, d’après une commission d’enquête sénatoriale.
² Le 10 septembre, un arrêt de la Cour de cassation a mis le droit français en conformité.
Représenter les cadres en Europe
Tamou Souary, de la CFTC Cadres, a été désignée pour représenter la France à Eurocadres. Cette association compte 6 millions d’adhérents. Elle influe sur l’avenir des Cadres en prenant part aux négociations européennes. Elle organise aussi des rencontres sur de nombreux sujets : intelligence artificielle et santé au travail, droit à la déconnexion, égalité salariale femmes-hommes… En 2026, elle s’attellera au devoir de vigilance, à la négociation pour les autoentrepreneurs… Elle siège aussi, au nom d’Eurocadres, dans deux comités permanents de la Confédération européenne des syndicats : « Emploi et Marché du travail » et « Qualité des emplois et pensions de retraite ».
L'IA VUE DE L'EUROPE
Denis Jeambrun, membre de la CFTC du Comité économique et social européen (CESE), nous livre ses réflexions sur l'intelligence articielle.
"L’intelligence artificielle (IA) est une révolution stupéfiante et rapide. D’un côté, elle peut produire des effets vertueux, comme des robots humanoïdes qui aideront les personnes âgées ou handicapées. De l’autre, elle peut avoir des effets pervers, comme une surveillance généralisée de la population.
Qu’en est-il pour les travailleurs ? À court ou moyen terme, les IA génératives permettront de remplacer les personnes, là où cela semblait totalement impossible il y a peu.
Par exemple, l’IA permet d'ores et déjà de créer rapidement et facilement du code informatique. D’ailleurs, nombre des plus grandes entreprises du logiciel, de la tech ou du conseil ont déjà licencié massivement pour substituer l'IA à l'humain. Par ailleurs, certains salariés utilisent l’IA sans le dire. Quand le management en prendra pleinement conscience, il pourra augmenter ses exigences : Un journalisme qui produit 5 articles par jour devra en produire 10, puis 50, puis peut-être davantage.
A la CFTC, que disons-nous ? À l’instar de la machine vapeur à l’aube de l’ère industrielle ou du smartphone aujourd’hui, l’IA s’impose à nous. D’une manière ou d’une autre, elle se répandra dans tous les domaines. Alors, ce que nous recommandons aux salariés, c’est de se l’approprier. Les syndicalistes, eux, doivent absolument s’y intéresser pour lutter contre les utilisations malveillantes envers les salariés. L’IA permet aussi d’analyser les accords ou de concevoir des tracts.
Au service de l’Homme
Côté européen, le défi est d'arriver à réguler efficacement l’IA en soutenant ses utilisations avancées vertueuses tout en combattant ses mises en oeuvre déviantes. Dans ses nouveaux objectifs de souveraineté, l'Europe doit aussi encourager la maitrîse de cette technologie. L’IA doit rester au service de l’Homme et non l'inverse. Elle doit oeuvrer pour le bien commun et non pour des intérêts contraire à la dignité humaine.
Enfin, l'IA doit se conformer aux valeurs européennes, et non être manipulée par des grandes puissances ou des milliardaires de la Tech. Pour ce faire, l'UE a adopté l’IA Act(2), en complément de la réglementation et des directives existantes. Il s'agit ici de contrôler l'IA, notamment par la transparence des processus d’apprentissage et la supervision humaines. Et de garantir aussi bien les libertés fondamentales que la robustesse des systèmes IA face aux cyberattaques."
¹ Denis Jacquet est co-auteur du livre C’est demain que tout commence (éd. Eyrolles), et Hervé d’Halluin est président de la Vie en bleu CFTC, n° 13, p. 26.
² Lire La Vie en bleu CFTC, n° 13, p. 24.
Le comité éconimique et social européen : Quésaco ?
Les 329 membres du CESE, représentant les 27 pays de l'UE, sont répartis en 3 groupes :
- Les employeurs
- Les travailleurs (syndicats)
- La société civile organisée (associations)
Ils sont consultés sur chaque directive et chaque réglement européen et peuvent aussi prendre l'initiative d'étudier d'autres sujets, en vue d'influer sur la politique européenne. Chaque membre peut proposer des amendements. Un groupe de travail débat, puis propose son avis. Le vote final a lieu en assemblée plénière.
"L'Europe, un géant qui ne doit plus s'ignorer !"
Le Président confédéral de la CFTC, Cyril Chabanier trace le portrait de l'Europe souhaitée et défendue par la CFTC.
La CFTC a toujours été particuliérement attachée à la construction européenne comme force de paix, de démocratie et de croissance. Elle a soutenu, dès les années 50 et tour à tour, l'émergence de la Communauté économique du charbon et de l'acier (CECA) puis de la Communauté économique européenne (CEE).
En outre, pour notre organisation, les récentes crises successives (sanitaire, énergétique, commerciale avec les droits de douane additionnels appliqués par les Etats Unis sur les exportations européennes) ont mis en lumière la nécessité de sécuriser nos sources d'approvisionnement et d'avoir une véritable démarche européenne en matière de souveraineté économique, numérique (notamment avec l'Intelligence Artificielle) et industrielle.
En effet, pour faire face à ces crises, les réponses - en matière d'investissement dans la recherche et le développement, d'intelligence artificielle... - doivent être pensées et mises en oeuvre à l'échelle européenne pour plus d'efficacité et d'efficience. Parce que l'Europe dispose de la "taille critique" pour concevoir, fabriquer, écouler, recycler tous les biens et services nécessaires à son indépendance. Pourtant, la production européenne reste trop souvent fragmentée, par exemple dans le domaine ferroviaire, où l'Europe compte de multiples réseaux ferroviaires nationaux distincts, avec des systèmes de signalisation ou des écartements de rails parfois différents.
Pour cela, l'Europe doit prendre conscience de sa puissance pour ne plus être, ce qu'elle est encore trop souvent, un géant qui s'ignore. En effet, contrairement à ce qui est souvent avancé, l'Europe n'est pas un nain économique ou politique. Le PIB cumulé des pays membres de l'UE fait d'elle la 2ème puissance économique mondiale, à égalité avec la Chine (environ 18 000 milliards d'euros en 2024). L'UE est également une puissance démographique importante (449 millions d'habitants contre 335 aux Etats Unis).
Dans le cadre de la CES ou du CESE européen, où notre mouvement siège, la CFTC pèse de tout son poids pour relayer ce message d'une Europe puissante, vecteur de progrès économique, écologique et social. Notre organisation défend tout particulièrement l'idée d'une Europe plus sociale, où la performance économique n'a de sens que si celle-ci contribue à préserver à long terme notre modèle social qui fait notre force. A ce titre et comme évoqué par Anne Chatain, la CFTC a poussé au sein de la CES pour une homogénéisation des salaires minimaux à l'échelle européenne (avec une directive adoptée sur ce sujet en 2022).
Comme dans les années 50, l'Europe est désormais à un tournant de son histoire. Pour ne pas disparaître, alors que les grands empires semblent être de retour, elle doit être capable de se réformer et de se doter d'instruments supplémentaires. Par exemple, une capacité d'emprunt communautaire sur le modèle du plan de relance Next Generation UE, la préférence européenne sur les biens industriels, etc, ... afin de maintenir et de créer à long terme des emplois durables et de qualité (notamment dans l'industrie), avec des niveaux de qualification et donc des salaires plus élevés qui contribuent, in fine, au financement de notre modèle social. Cette Europe, que la CFTC appelle de ses voeux, n'est malheureusement que très rarement l'Europe que nous avons sous les yeux.